1. Êtes-vous une collectionneuse de mots ?
J'ai déjà élaboré un recueil où je tentais d'inscrire le plus possible, les mots dont j'ignorais la signification, les mots que je voulais ajouter à mon écriture personnelle ou encore les mots dont l'orthographe attirait mon attention pour une raison ou une autre. À ma grande déception, j'ai mis de côté ce projet, faute de motivation, Toutefois j'ai quand même conservé le tout dans l'espoir de continuer d'enrichir mon lexique...un jour. Maintenant, le cours présent m'incite grandement à poursuivre cette initiative tantôt délaissée.2. Qu'est-ce qu'un dictionnaire ? un glossaire ? un lexique ?une encyclopédie ? une terminologie ?
Selon Le Nouveau Petit Robert:
Un dictionnaire est un recueil d'unités signifiantes de la langue rangées dans un ordre convenu, qui donne des définitions, des informations sur les signes.
Un glossaire est en quelque sorte un dictionnaire ne donnant que les mots difficiles ou peu connus.
Un lexique réfère au dictionnaire d'un auteur.
Une encyclopédie contient des rensignements sur les choses, les idées désignées par les mots, et traitant les noms propres.
La terminologie relève d'une langue spéciale, c'est-à-dire qu'elle réfère à un vocabulaire propre à un domaine de connaissances.
3. Quelle est la fonction du dictionnaire ?
Les dictionnaires nous en apprennent plus qu'on ne le pense bien souvent. Ils nous renseignent non seulement sur les significations possibles d'un mot, mais sur ses emplois dans une phrase, sur ses fonctions, sur le détail de sa nature, etc. Bref, les définition nous en disent long sur le fonctionnement de la langue.
4. Combien de dictionnaires possédez-vous ?
Pour tout dire, je dois avouer que je me contente souvent de mon Petit Robert de poche. ( Cela fait bien cinq ans que je demande Le Petit Robert à Noël, mais le Père Noël juge que je ne le mérite pas encore ) . Je possède également un Multi dictionnaire plus ou moins récent, deux dictionnaires des synonymes dont Le petit druide des synonymes, et mon bon vieux dictionnaire anglais - français qui me sert régulièrement.
5. Consultez-vous souvent vos outils de référence ?
Bien que je ne sois pas hautement équipée en dictionnaires, ceux que j'ai font partie de ma vie de tous les jours ( de septembre à mai...), tout comme mes références en grammaires accumulées depuis le secondaire ( je me rends compte que c'est presqu'une collection ) . Hors cours: je me dois toujours de valider toute question ambiguë rencontrée.
6. Les dictionnaires sont-ils tous semblables?Selon vous, en quoi divergent les dictionnaires ? (composantes, nombre d'entrées, taille de l'ouvrage...)
Selon moi, ce qui différencie un dictionnaire d'un autre ( et qui m'importe ), c'est le type d'information apportée pour un mot. Par conséquent, il est normal que le nombre d'entrées par exemple, soit différent de l'un à l'autre. Pour ma part, je préfère, et de loin, un dictionnaire typiquement de langue que tout autre. Par contre, lorsque l'on étudie la langue, il devient très intéressant de comparer ces différentes approches pour ensuite être en mesure de mieux sélectionner les outils dont on a besoin.
7. Est-ce que tous les mots sont acceptables dans un dictionnaire ? (Qui décide de la norme ?)
Comme nous en avons déjà discuter dans l'ordre d'un autre cours, certains dictionnaires sont plus à l'affût des nouveaux mots, de la nouvelle orthographe, etc. que d'autres. Toutefois, il arrive souvent que des mots en vigueur ne soient pas répertoriés immédiatement dans les dictionnaires avant quelques années. Apparemment que l'OLF soit plus avant-gardiste que les dictionnaires. Maintenant qui juge de la norme? Peut-être ceux qui écrivent...sans doute. Mais également ceux qui lisent... Cela reste à voir.
8. Connaissez-vous des dictionnaires de fabrication québécoise ? (lesquels)
Je suis plus ou moins familière avec ce genre d'ouvrage pour l'instant, quoique je suis très intéressée à en savoir davantage sur la langue de chez nous.
9. Si vous êtes un collectionneur de mots, pouvez-vous me donner des exemples de particularismes (faune, flore, alimentation, culture, expressions familières) de votre région (incorporer des photos sur votre blog pour illustrer ces réalités).
À part la tourtière, la grosse bière, les feux de joie trop fréquents et « bin des afféres qui s'disent pas »....je ne saurais comment qualifier ces particularités du Lac comme on dit. Toutefois, le sujet n'est pas clos...

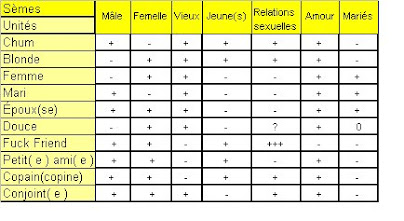
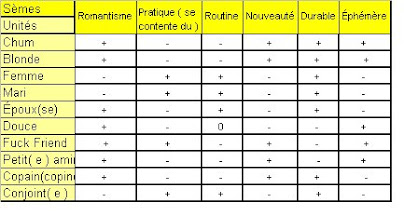

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire